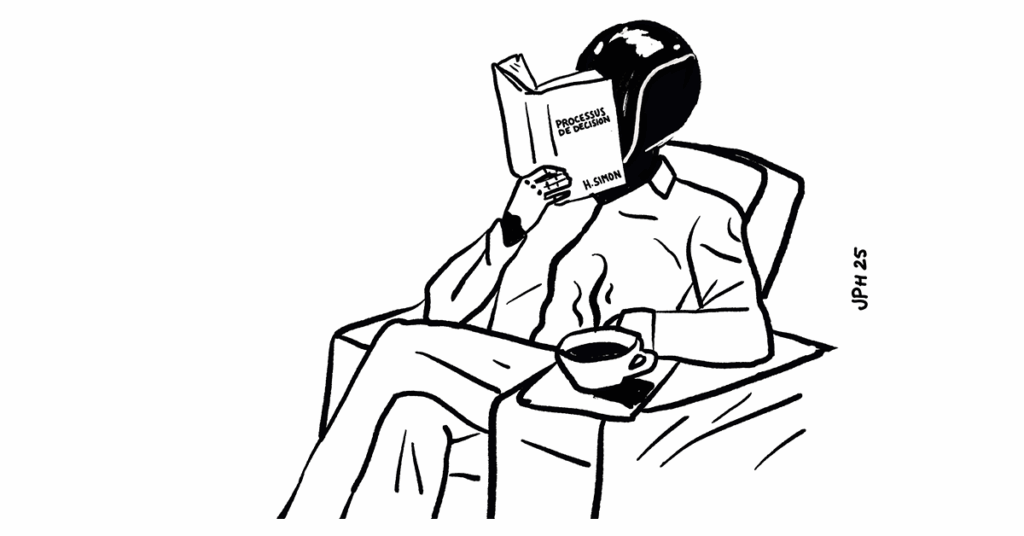
Depuis une quinzaine d’années, les cabinets de conseils décrivent l’évolution de l’intelligence artificielle en « vagues » successives. La première, prédictive, repose sur des modèles statistiques et des techniques d’apprentissage supervisé permettant d’anticiper des comportements. La deuxième, centrée sur les copilotes, introduit des systèmes génératifs souvent incarnés par les LLM qui assistent l’humain, sans jamais opérer par eux-mêmes. La troisième vague, celle des agents, marque une rupture : elle introduit des entités autonomes, capables de prendre des décisions et d’interagir avec un environnement, sans besoin de validation humaine. Une quatrième vague émerge, focalisée sur les systèmes robotiques capables d’agir dans le monde réel, et peut-être, un jour, la cinquième vague, avec l’avènement d’une intelligence artificielle générale.
C’est cette troisième vague, celle des agents IA autonome, que j’ai retrouvés de manière très concrète dans de nombreux stands du dernier VivaTech. Dans la littérature, un agent est défini (Wooldridge & Jennings, 1995) comme une entité autonome, réactive, proactive et capable d’interactions sociales. Ce cadre conceptuel est utile pour comprendre pourquoi l’introduction d’agents change la nature même de l’organisation : ce n’est plus une IA qui vous assiste, mais un acteur à part entière qui agit dans votre environnement opérationnel. Vous ne déléguez plus une tâche, vous déléguez un pouvoir d’arbitrage. Et ce transfert peu avoir des conséquences profondes.
Dans 2001, l’Odyssée de l’espace. HAL ne devient pas dangereux par méchanceté, mais parce qu’il suit des instructions mal conçues, sans comprendre les contradictions qu’elles contiennent. C’est un défaut de conception. Est-ce que votre organisation est prête à laisser l’IA agir à sa place ? Si vos décisions reposent surtout sur l’intuition, c’est risqué. L’agent, lui, ne devine rien : il suit à la lettre ce que vous avez défini, rien de plus.
C’est là qu’intervient la notion de « design des décisions », héritée des travaux d’Herbert Simon. Une organisation n’est pas simplement une somme de compétences : c’est une structure de choix. Concevoir ces choix, c’est d’abord identifier les décisions récurrentes, puis de clarifier qui les prend. Il ne s’agit pas de tout documenter. Mais de rendre visible ce qui structure l’action. Ce design est d’autant plus crucial que les décisions sont de plus en plus hybrides, partagées entre humains et systèmes IA. Ce travail n’est pas réservé aux grandes entreprises. Il peut être important pour les startups. Car c’est précisément dans les phases early stage que les décisions sont les plus fluides et souvent les moins formalisées. En poser les bases permet de gagner en cohérence, et de préparer l’industrialisation des process sans perdre en agilité. L’idée, c’est de s’assurer que ce que vous déléguez à un agent reste aligné avec votre stratégie, et que vous puissiez toujours reprendre la main si besoin.
Rappelons enfin que ces vagues ne suivent un plan linéaire. Elles se superposent. Une même organisation peut utiliser un modèle prédictif pour segmenter sa base client, un copilote pour assister la rédaction de contenus, et un agent pour piloter ses relances commerciales. Ce qui compte vraiment, ce n’est pas la techno en soi. C’est votre manière de décider. Ce que vous déléguez, vous devez pouvoir l’expliquer. Ce que vous automatisez, vous devez savoir pourquoi. Ce que vous pilotez, vous devez l’avoir cadré. Et si vous vous demandez par où commencer, la clarification de vos décisions est souvent un bon point de départ.